Voyager. Je crois qu’après la découverte du feu et de la fourchette, ça a dû être la passion que l’homme a essayé de développer le plus. En fait, en y réfléchissant bien, le voyage a un aspect assez religieux : le pèlerinage, effectué par les divers prophètes et leurs apôtres ; sinon, les seuls qui voyageaient souvent étaient les marchands et les explorateurs (on pense ici bien évidemment à Marco Polo, pensez-y pour votre rattrapage du bac, c’est important). Bref, vous l’aurez compris, le voyageur ancien possède un but concret, tandis que nous, à notre époque, on voyage simplement pour bronzer et ramener des statuettes en terre cuite.
« Leur souhait est littéralement d’avaler le monde »
Seulement, dans les années 50 aux États-Unis, naquit un mouvement appelé Beat Generation. Ces gens-là, jeunes américains passionné d’écriture, de voyages et de jazz, reprennent à leur sauce cet acte de voyager, pour l’amplifier et en faire quelque chose de beaucoup plus mystique. Leur souhait est littéralement d’avaler le monde, de le connaitre dans les moindres recoins, pour pouvoir le recracher dans leur littérature. Généralement, on cite trois auteurs principaux de ce mouvement : Allen Ginsberg, William S. Burroughs (qui a une histoire « particulière » cf. Wikipédia) et Jack Kerouac. Ce dernier, vous devez sans doute le connaître, puisqu’il est l’auteur de Sur la route, oeuvre monumentale et ode à la liberté de déplacement. Dans une Amérique qui revient de la guerre, on peut dire que ces trois jeunes mecs n’avaient plus envie de rêver à la manière dictée par l’oncle Sam ; faire de l’argent ne les intéressait pas, et leur seul désir restera de témoigner des gens et des paysages rencontrés.
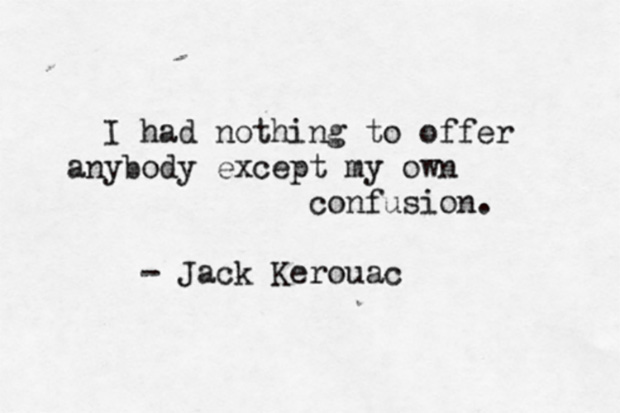
« Un monde où rien ne se termine tant qu’on est pas entre quatre planches »
Kerouac au fond, c’est plutôt pas mal. On a l’impression de lire un pote à nous, qui nous raconte ses voyages, avec toutes les escales et les galères. Sauf que lui, il trouve toujours un moyen de fumer de la marijuana ou mâcher du peyotl (au Mexique), ou goûter à l’opium (à Tanger, en Algérie). Et finalement, il semblerait que trop de liberté, finisse par tuer la liberté. Parce que, en lisant Sur la route, on comprend que faire San Francisco – New-York est une aventure en soi ; mais dites-vous bien qu’il faut revenir ensuite. À l’époque, il fallait quelques semaines. Et puis Kerouac aime aussi le Mexique, alors pourquoi pas faire New-York – Mexico ? Allons-y. Tant que la voiture roule, tout roule. Et nous, en lisant, on a l’impression que c’est facile. Que tout est facile, que les rencontres sont faciles, que le monde est facile (que les filles qu’il rencontre, elles aussi, sont faciles). C’était l’Eldorado d’après-guerre, dans un monde où rien ne se termine tant qu’on est pas entre quatre planches. Pourtant, une note de lassitude apparaît. Le même genre que celle que l’on a, quand on possède enfin l’objet que l’on a longtemps désiré : on en profite, et puis on le met dans un coin et on l’oublie. Kerouac se lasse de cette liberté et c’est certainement la plus grande leçon à apprendre de son oeuvre. On ne peut pas trouver la quiétude, comme il le dit lui-même, si l’on ne s’arrête pas quelques instants.
Rien que pour le souffle et le style de l’auteur, je vous encourage vivement à lire Sur la route. Même si ça fait peur, prenez le temps de partir avec lui (il y aura des tas de bouchons pour aller et partir de la plage, j’en suis sûr). Je vous conseille en supplément de lire Les anges vagabonds, qui fait un peu office de suite ; la partie mexicaine est beaucoup plus intéressante. Surtout le côté mythologie. Je comprends pas ce qu’on leur trouve, moi, à ces pyramides mayas… C’est juste un tas de caillasse non ?



